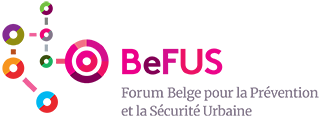Victimisation et réhabilitation
La réhabilitation des auteurs et l’accompagnement des victimes constituent deux objectifs primordiaux de la justice restaurative. Cette forme de justice permet d’agir, parallèlement aux actions de prévention, contre la récidive et le sentiment de “victimisation”.
Réhabilitation des auteurs et gestion de la récidive
Le développement de la justice restaurative demande un accompagnement strict des auteurs judiciarisés afin d’éviter la récidive en développant une justice alternative basée sur la réparation du dommage, la conscientisation des auteurs et la médiation entre auteur et victime. Les auteurs non judiciarisés et les mineurs sont des publics qui nécessitent une attention particulière afin de leur
éviter toute entrée dans l’entonnoir pénal. Cette justice alternative permet également d’éviter au mieux le sentiment de victimisation des auteurs.
1° Introduction
De façon générale, la réhabilitation renvoie à l’idée que l’on puisse avoir recours aux mesures pénales afin de transformer les personnes judiciarisées de façon à ce qu’elles deviennent des individus qui puissent répondre à un certain nombre de critères normatifs et politiques. La finalité de la réhabilitation est une autonomisation des individus c’est-à-dire de produire des individus en mesure d’agir par eux-mêmes à titre de sujets1.
La “réhabilitation des auteurs 18-25 ans” fait référence aux actions mises en place pour aider les auteurs d’infractions, à la sortie de prison ou lors d’une mesure judiciaire alternative, à se (ré)insérer dans l’ensemble des dimensions de la société. Les personnes de 18-25 ans font référence à une certaine catégorie que l’on nomme ici “la jeunesse”.
Ce public particulier demande un traitement spécifique car souvent, la peine privative de liberté n’a que peu d’impact sur la prévention de la récidive et ce, en raison de leur situation souvent multi problématique comme par exemple : un très faible niveau scolaire, une expérience professionnelle limitée ou une attitude problématique au travail, des dettes considérables, des problèmes de logement, des usages de drogues et/ou d’alcool, un sentiment de rejet et de défiance envers les institutions, etc.
La transition entre la prison et le monde extérieur peut être très difficile et certains se sentent “catapultés”. Il est alors important d’anticiper cette situation et de guider ces personnes. Le mieux serait d’éviter les peines privatives de liberté en se tournant vers des peines à dimension pédagogiques appelée “mesures judiciaires alternatives”.
Le développement de la justice restaurative demande un accompagnement strict des auteurs judiciarisés afin d’éviter la récidive en développant une justice alternative basée sur la réparation du dommage, la conscientisation des auteurs et la médiation entre auteur et victime. Cette justice alternative permet également d’éviter au mieux le sentiment de victimisation des auteurs.
Par exemple, en 2018, le législateur encourage les formes alternatives de résolution des litiges en proposant une définition de la médiation pénale ainsi que les critères qui la distingue de la médiation extra judiciaire :
- La médiation est “judiciaire” lorsque le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation, est nommé par le juge à la demande des parties, ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci.
- La médiation est “extra judiciaire” lorsque les parties, qui sont ou non en procès, s’accordent, sans en référer au juge, pour tenter une médiation et ce, en se conformant au mode légal, c’est-à-dire en signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi et en faisant appel à un médiateur agréé.
Les SEMJA (Services d’Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives) sont chargés quant à eux de mettre en place et d’organiser au niveau local, les peines de travail autonomes (PTA) et des travaux d’intérêt généraux (TIG) en veillant à l’utilité publique des prestations.
Les peines de travail d’intérêt général (de 20 à 300 heures) sont proposées seulement aux personnes majeures pour des infractions n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. La peine de travail d’intérêt général est exécutée gratuitement dans les services publics et les associations sociales, culturelles ou scientifiques.
En Belgique, le système carcéral se trouve dans un état de crise quasi permanent. Un consensus se dégage autour du fait que les prisons belges ne sont plus appropriées pour réaliser leur tâche centrale : la préparation individuelle et sûre des personnes à un retour réussi dans la société.
C’est pourquoi, une approche intégrale et surtout intégrée doit être promue via l’action “transversale” au sein du développement indispensable de la justice alternative.
Une question empirique pertinente se pose alors : quel véritable encadrement des mesures judiciaires alternatives (TIG/PTA) en Belgique ?
Deux enjeux principaux ont été identifiés dans l’élaboration d’une stratégie transversale de réhabilitation des auteurs 18-25 ans :
- Les SEMJA semblent des services voués à l’échec (base légale inexistante, définition des rôles peu claire avec les autres maillons de la chaîne comme les maisons de justice, manque de moyens et d’effectifs humains, raréfaction des lieux de prestation, l’augmentation des personnes au profil multidiagnostic …)
Sur ce point, le Befus a de nombreuses fois contacté le Ministre de la Justice afin de demander une reconsidération des SEMJA via l’octroi de frais de fonctionnement, une re-négociation des conventions futures, par la clarification du mode d’évaluation des semjas, et par une refonte (réalisée en concertation avec les acteurs de terrain) des avantages de l’ancienne loi (enquête sociale, guidance, arrêt de l’obligation légale de l’envoi d’un recommandé, …) avec ceux de la nouvelle loi (application automatique d’une peine subsidiaire en cas d’inexécution volontaire de la peine de travail,…).
- Au sein des mentalités, l’aspect “réinsertion” doit encore se faire une place afin de se substituer à l’aspect “répressif” de la peine et de l’après-peine.
2° Pratiques prometteuses :
Les villes et communes belges développent leur propre politique locale de prévention, de sécurité et de cohésion sociale. En tant qu’organisation à but non lucratif au service des collectivités locales, BeFUS asbl facilite la coopération, le soutien et l’inspiration dans la lutte contre les phénomènes liés à la sécurité et le déploiement de méthodologies innovantes.
Parmi le nombre important de pratiques prometteuses qui ont été élaborées, encouragées ou promues par le BeFUS asbl depuis 25 ans, nous souhaitons en présenter certaines qui ont eu un rôle majeur dans la stratégie de réhabilitation des auteurs 18-25 ans et qui respectent les critères analytiques suivants : une méthodologie prometteuse, une approche transversale, une nécessité d’adaptations du cadre légal, un financement particulier, une évaluation et/ou une communication hors du commun.
Les pratiques sont relatives aussi bien à la réinsertion post-détention, au développement de la justice restauratrice, qu’à l’inclusion de la jeunesse dans l’idée d’un travail global et systémique.
Le BeFUS, vecteur de transversalité, n’a cessé de promouvoir ce mode d’action. A titre d’exemple, nous retrouvons les pratiques suivantes :
2007 : lancement du réseau national FEDEPAS (Fédération pour les peines de travail autonomes), organisation de fait ayant pour but de rassembler les services d’encadrement des mesures judiciaires alternatives néerlandophones et francophones établis à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Depuis mars 2012, la FedepAs fait partie du BeFUS. C’est un lieu d’intervision où sont abordés des sujets propres à la pratique de terrain. Soulignons 2 projets :
- Cahier de méthodologie des SEMJA
- Fiche relative aux problématiques récurrentes auxquelles les coordinateurs des SEMJA font face
2009 : le Prix belge de prévention de la criminalité récompense le projet “U-TURN”, De Overstap asbl. Ce projet propose un accompagnement de trajet individuel intensif aux jeunes habitants d’Anvers âgés de 18 à 30 ans. Les problèmes plus spécifiques à la jeunesse (scolarité, logement, emploi, etc.) sont abordés dans le cadre d’un accompagnement individuel, mais aussi de formations de groupe sur la base de la méthode Equip. Les jeunes apprennent ainsi à acquérir des aptitudes sociales, à maîtriser leur colère et à faire moralement de bons choix.
2010 : projet “Jeunes Jugés Dérangeants” à Charleroi afin de dénouer les tensions par la médiation. La cellule “JDD” a pour mission de gérer les plaintes, objectiver les faits, écouter les jeunes et les habitants, jouer un rôle de relais pour réduire les tensions et construire des solutions concrètes en partenariat avec les acteurs locaux. La cellule s’appuie sur une méthodologie spécialement créée, “Méduc”, qui fait collaborer les médiateurs de quartier et les éducateurs de rue.
2014 : projet “BruXitizen” dont l’objectif est de créer un espace de rencontre entre jeunes de tous horizons (16 à 25 ans), de différents quartiers et susciter une vision critique et engagée sur les problématiques que rencontrent les jeunes. La thématique centrale de l’année 2014 (3ième édition) était : “Emploi, quartier, police : jeunesse entre contrôle et autonomie ?” (Molenbeek).
25/02/2015 : projet pour l’harmonisation règlementaire des SEMJA. Courrier du BeFUS à la Fédération Wallonie Bruxelles Administration générale des maisons de justice.
2020 : Projet de “maison de transition” (à Malines, soutenu par le SPF Justice et G4s) : action qui consiste à trouver un plan de vie (par étape) au détenu avant sa sortie. Détention à petite échelle dans un foyer de 15 détenus logés à partir de 12 mois avant la libération conditionnelle et sélectionnés dans toutes les prisons de Belgique pour leur “capacité de réinsertion”. Une deuxième maison a également été créée à Enghien en janvier 2020.
3° Conclusion
Le BeFUS asbl offre la possibilité de relever des défis sensibles/nouveaux/(ré)émergents et de s’appuyer sur l’expertise déjà acquise dans ce domaine. Aux vues des enjeux présentés précédemment, en 2020, nous souhaitons insister sur la nécessité de soutien aux actions qui reposent sur le développement de la justice restauratrice et ce, via la constitution de partenariats afin de pouvoir travailler en commun au niveau de chacune des dimensions de la réinsertion/réhabilitation.
Les services communaux de prévention sont mis en avant comme l’acteur pivot de la gestion partenariale de la réhabilitation grâce à leur mode de fonctionnement inclusif et polyvalent et leur ancrage local qui facilitent la dynamique participative et de proximité entre les acteurs et les institutions. De plus, l’élu local doit pouvoir exercer un droit de regard sur le monde carcéral et faciliter la construction de passerelles entre l’intérieur et l’extérieur des prisons. Or, cette construction repose souvent sur l’action d’associations qui jouent un rôle clef dans la réhabilitation et la réinsertion des anciens détenus (résolution du Comité Exécutif de l’EFUS, 2011).
Les principaux défis à relever afin de parvenir à développer un travail transversal et de collaboration pour la réhabilitation des auteurs de 18 à 25 ans sont :
- Le besoin de coopérer avec le système judiciaire au niveau local pour jouer un rôle et faciliter la réintégration dans l’optique de limiter au maximum l’impact de la peine privative de liberté.
Au niveau des SEMJA, plusieurs recommandations persistent :
- Nécessité de reconnaissance officielle du statut des SEMJA
- Concertation avec les SEMJA dans l’évaluation de l’application de la loi sur les PTA (annoncée mais pas encore concrétisée)
- L’accès aux informations et le partage du secret professionnel
- Concertation avec les SEMJA concernant les possibilités de lieux d’accueil (développement des lieux de prestation, prise en charge des frais médicaux…)
- Le financement des services d’encadrement des SEMJA (y compris les frais de fonctionnement) ne peut être pris en charge par les villes et communes
Le suivi des auteurs doit être mis au point grâce à l’amélioration des relations entre services locaux/police et services citoyens. En effet, durant la crise sanitaire Covid-19, de nombreuses difficultés ont été rencontrées par les acteurs chargés de la réhabilitation des auteurs 18-25 ans : la fermeture des lieux de prestations des mesures alternatives, la mise au ralenti des services d’aide concernés et les conséquences de la pandémie sur le monde la justice et les conditions pénitentiaires … Ces exemples ont à nouveau prouvé la nécessité de mettre au point des partenariats solides permettant un réel travail en réseau autour du jeune afin qu’il soit réhabilité au sein de l’ensemble des sphères sociales dont il s’est exclu. Ceci repose entre autres sur une évolution des mentalités (au niveau des politiques publiques mais également vis-à-vis des citoyens) encourageant une gestion préventive de la récidive et un travail inclusif du jeune en voie de rupture pour une meilleure cohésion sociale.
Aide aux victimes
L’accompagnement des victimes est essentiel. Il peut être réalisé en amont grâce aux pratiques de sensibilisation quant aux comportements à adopter sur l’espace public afin d’éviter de devenir victime. Une fois victime, il s’agit de développer un réel encadrement afin de leur éviter un sentiment de “double victimisation”, mais aussi de développer les politiques de gestion des situations de crise, où un grand nombre de victimes se retrouvent démunies.
Victimes de la nuit
La problématique des agressions sexuelles le soir mérite amplement d’être surveillée de près. La prévention, le contrôle de la situation et la prise en charge des victimes permettent de renforcer la tranquillité publique et de redorer l’image des institutions de nuit.
- Introduction
Le monde de la nuit offre la possibilité pour la population de se détendre et de faire la fête. Les comportements sont susceptibles de changer du fait de consommation d’alcool et de drogue. Les réactions des personnes festives sont dès lors fort différentes de celles rencontrées pendant la journée. La nuit désinhibe souvent les comportements. Durant la fin de l’année 2021, Bruxelles et sa population ont été témoins d’agressions sexuelles le soir dans certains établissements de nuit ou bars. Ces crimes étaient facilités par l’usage de drogues (GHB, MDMA, etc.) de la part des auteurs. Les victimes sont sorties de l’ombre, avec des mouvements comme #BalanceTonBar, pour dénoncer ces agissements et pointer du doigt de nombreux problèmes dans la réaction apportée. Trop souvent, la victime qui rapporte de tels faits est confrontée à bien peu de considération. Des questions sont posées sur la consommation d’alcool de la victime (était-elle saoule ou non ?), sur sa tenue, etc. Ces paroles mettent en avant une responsabilité de la victime, créant ainsi une double victimisation.
On comprend très vite pourquoi ce phénomène ne doit pas être pris à la légère. Premièrement, puisqu’il porte atteinte évidemment à l’intégrité physique et psychologique des personnes victimes de ces actes. Deuxièmement, ces évènements portent atteinte à la confiance que la population attribuait aux établissements de nuit et cela crée également un sentiment d’insécurité. Les activités de nuit représentent un marché économique important, marché qui dès lors se verrait restreint par ce sentiment d’insécurité qui parait être grandissant. Enfin, la confiance placée dans les autorités pour réagir et prendre en charge les victimes s’est également érodée ce qui pose, au sein de la population, des questions de légitimité.
Les atteintes sont donc multiples et diverses. Les enjeux comprennent des questions :
- De sécurité : comment mieux assurer la sécurité des consommateurs ? Quel travail de prévention effectuer ?
- Économiques : comment redorer le blason des établissements de nuit pour inciter les personnes à continuer de les fréquenter ?
- De légitimité : quel rôle les autorités locales peuvent-elles jouer pour endiguer efficacement les agressions sexuelles dans les bars ? Comment éviter les discours de double victimisation ?
- Pratiques prometteuses
Les autorités locales qui gèrent les établissements de nuit connaissent mieux la situation que d’autres autorités situées sur des échelons plus élevés. Le local semble le mieux placé pour prendre en charge la situation et promouvoir des pratiques efficaces pour endiguer ces pratiques. Les autorités locales sont plus proches du citoyen et peuvent donc promouvoir un certain type de pratiques plus efficacement.
Voici des exemples de pratiques pour lutter contre les agressions sexuelles :
- Les centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) sont des centres spécialisés pour recevoir les victimes d’agressions sexuelles. Il en existe trois en Belgique actuellement. Ayant vu le jour il y a trois ans, ces centres proposent des services spécifiques pour prendre en charge la victime :
- Des soins médicaux
- Un examen médico-légal qui contribue notamment à la récolte de preuves utiles en cas de dépôt de plainte éventuelUn soutien psychologique pour écouter la victime avec la possibilité d’un suivi pour permettre à cette dernière de se reconstruire
- La possibilité de porter plainte auprès de la police qui fait le déplacement. Cela évite à la victime de se rendre dans un commissariat, qui correspond à une démarche lourde après un viol.
Force est de constater que ce service n’est pas préventif des violences sexuelles, et est surtout réactif, mais il est pourtant primordial. En effet, ce dont la victime a besoin est mis à sa disposition immédiate et un véritable suivi est créé. De plus, au-delà de cette mission principale qui est de prendre soin de la victime, des échantillons peuvent être récoltés (sperme, cheveux, tissu) dans un délai bref en fonction évidemment du moment où la victime consent à se rendre dans un CPVS. Ces preuves sont principalement des matériaux biologiques et disposent d’une durée de vie fort limitée. La promotion d’une prise en charge rapide est donc essentielle, ces éléments de preuve peuvent servir de base pour rechercher la vérité et prouver la culpabilité de l’auteur des faits.
- La ville de Malines compte mettre en place le programme du “Ask for Angela”. Lancé en Angleterre en 2016, le programme “Ask for Angela” permet aux personnes qui se sentent en danger, et qui n’ont personne vers qui se tourner, de demander Angela auprès des serveurs/serveuses, tenanciers, organisateurs, etc. Agissant comme un nom de code, ceux-ci comprennent que quelque chose ne va pas et peuvent prendre alors des mesures pour remédier à la situation. Ce programme requiert un minimum de mise en place, à savoir l’affichage de posters dans les toilettes de l’établissement permettant de prendre connaissance du code. Celui-ci peut évidemment varier. On peut très bien imaginer une commande d’un cocktail qui n’est pas affiché aux yeux de tous, etc. La réponse apportée peut tout aussi bien changer selon les établissements mais aussi en fonction de la situation. Faire sortir la personne discrètement, l’accompagner dehors et lui appeler un taxi.
- La ville de Bruxelles a également établi un plan d’action appelé “Rien sans mon consentement”1. Ce plan met en avant 77 mesures pouvant être utilisées pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles. On peut retrouver à travers ce document des formations des agents de police pour les sensibiliser à la situation de la victime pour notamment éviter la double victimisation. Ce plan d’action travaille entre autres sur le développement d’un plan spécifique dit “nuit”.
- Des applications existent pour prévenir des actes attentatoires à la sécurité des personnes. La plupart du temps, la promotion de ces applications se fait à un niveau européen, mais envisager une promotion au niveau local reste une possibilité. L’application “RightsApp” permet notamment aux citoyens d’avoir un accès rapide au numéro d’urgence 112, un accès aux droits des victimes par l’utilisation d’un questionnaire et l’apport d’informations sur les centres d’aide aux victimes, entités, consulats, ambassades, etc. “App-Elles” constitue un autre exemple d’application permettant ici de lutter spécifiquement contre la violence basée sur le genre. Cette application s’axe sur trois branches : l’aide, le support et l’apport d’informations. L’aide est apportée à la victime à travers un réseau de personnes de confiance qu’elle construit, par la géolocalisation de son appareil et permet à la victime d’être entendue en temps réel. Le support est constitué d’un réseau de lignes téléphoniques professionnelles de crise pour les victimes et les témoins. L’apport d’informations représente des outils mis à la disposition du citoyen : cartes, conseils, sites, etc. Cette application constitue un bénéfice pour les autorités locales puisqu’elle permet, entre autres, d’augmenter la visibilité des services et programmes locaux, de centraliser les informations qui seront gérées par les administrateurs locaux et des coûts partagés de communication et pour la mise en place d’outils2. Enfin, l’application “Umay” sert à répertorier des lieux sécurisés pour les victimes de harcèlement de rue. Elle comprend un bouton d’alerte et une carte reprenant les lieux/abris pour les victimes3.
- Conclusion
Les actions de prévention en ce qui concerne la violence dans les établissements de nuit relèvent de la compétence du local. En effet, ce sont ces autorités qui connaissent le mieux les différents quartiers, établissements et parfois même les gérants. Elles sont donc les plus à même de mener des actions “chirurgicales”, en agissant avec une meilleure précision que ne le feraient d’autres autorités supralocales.
Les projets en la matière continuent d’être développés. L’EFUS a récemment publié un appel à projets4 pour prévenir et combattre la violence basée sur le genre ayant comme objectifs de « renforcer la capacité des autorités locales et régionales à détecter, prévenir et combattre la violence fondée sur le genre, en particulier la violence domestique […] ».
BeFUS, en tant que réseau de communes belges, souhaite mettre en partage les outils et les discussions sur cette matière pour arriver en finalité à la construction d’une boite à outils permettant de lutter efficacement contre ces violences. Ces agressions sexuelles gangrènent le sentiment de sécurité de la population et la confiance que celle-ci place dans les autorités à contenir la situation, il semble donc important d’apporter une réponse rapide et efficace.